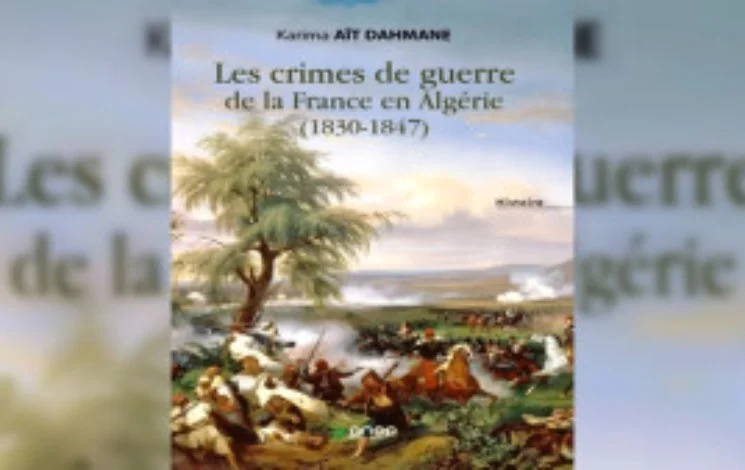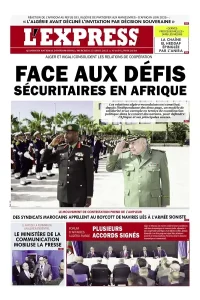Dans Les Crimes de guerre de la France en Algérie, 1830-1847, l’universitaire Karima Aït Dahmane plonge dans l’histoire violente et méconnue de la conquête coloniale française, un chapitre où la barbarie a servi de doctrine d’occupation. En s’appuyant sur des archives officielles françaises, elle expose avec rigueur la réalité d’une guerre où l’extermination des populations indigènes a été pensée, organisée et mise en œuvre par l’armée coloniale.
Loin des récits aseptisés qui ont marqué l’historiographie française, ce livre démonte les falsifications historiques et met en lumière l’ampleur des exactions commises contre les Algériens. Massacres de masse, enfumades, décapitations, pillages systématiques, l’armée d’occupation a appliqué des méthodes qui relèvent du crime de guerre et du crime contre l’humanité, bien avant que ces termes ne soient consacrés par le droit international.
Dès l’expédition d’Alger en 1830, la colonisation s’est imposée par la terreur. La prise de la capitale marquait le début d’une campagne d’anéantissement dirigée contre les tribus et villages qui résistaient à l’avancée française. « Il faut un grand exemple et faire peur », écrivait le maréchal Clauzel, qui ordonna des destructions massives pour briser toute velléité d’opposition.
Le général Thomas-Robert Bugeaud, gouverneur général de l’Algérie en 1840, théorise cette violence en instituant la guerre totale contre les populations civiles. « Il faut brûler les moissons, vider les silos, abattre les arbres fruitiers », préconise-t-il dans ses écrits. Sa stratégie repose sur la politique de la terre brûlée et le harcèlement permanent des tribus. Il met en place des colonnes mobiles, unités de cavalerie et d’infanterie qui parcourent le pays en semant la désolation, villages incendiés, habitants exécutés ou déportés.
Parmi les méthodes les plus atroces, les « enfumades » restent l’un des symboles de cette politique de terreur. En 1844, le général Cavaignac ordonne d’asphyxier des centaines d’Algériens réfugiés dans une grotte du Dahra, un procédé que son successeur, le général Pélissier, reproduira un an plus tard à la grotte de Ghar El Frachih. « La fumée les étouffera mieux que nos baïonnettes », écrit-il cyniquement dans un rapport adressé à sa hiérarchie.
Les chiffres de cette guerre d’anéantissement sont vertigineux. Selon les sources françaises, entre 500 000 et un million d’Algériens trouvent la mort entre 1830 et 1870 sur une population initiale estimée à trois millions d’habitants. D’autres sources algériennes avancent le chiffre de dix millions, un débat qui, bien qu’ayant ses zones d’ombre, ne remet pas en cause l’ampleur du drame, la conquête coloniale a décimé près de la moitié de la population en quelques décennies.
Face à cette machine de guerre, une résistance farouche s’organise. À partir de 1832, un chef se distingue par sa capacité à structurer la lutte contre l’occupant : l’émir Abdelkader. Formé à la fois à la théologie soufie et aux stratégies militaires, il comprend vite que l’affrontement direct avec les troupes françaises est voué à l’échec. Il privilégie une guerre de mouvement, harcelant les colonnes françaises et multipliant les attaques ciblées.
Bugeaud, Saint-Arnaud, Lamoricière, Clauzel, Cavaignac, tous reconnaissent dans leurs correspondances la ténacité et le génie militaire de l’émir Abdelkader, qualifié de « redoutable » et « insaisissable ». Mais en 1843, un événement fait basculer la guerre, la prise de la Smala. Ce gigantesque camp itinérant, abritant plus de 30 000 personnes, est attaqué par surprise par le duc d’Aumale. L’émir y perd non seulement des hommes, mais aussi des armes, des manuscrits et des richesses considérables.
Dès lors, l’étau se resserre. En 1844, la défaite marocaine à la bataille d’Isly prive Abdelkader d’un soutien stratégique majeur. Traqué de toutes parts, il finit par se rendre en 1847 au général Lamoricière, plus pour éviter de nouveaux massacres de civils que par capitulation militaire.