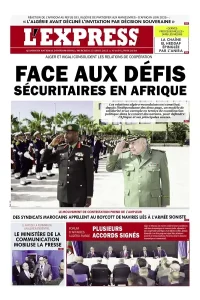L’Algérie ambitionne de se positionner comme un acteur clé dans le domaine de la recherche scientifique. De l’agroalimentaire aux énergies renouvelables, en passant par l’hydraulique et les sciences des matériaux, le pays affiche des avancées notables. Mais un obstacle de taille freine cette dynamique: le financement.
Invitée sur les ondes de la chaîne 2 de la Radio Algérienne, Ait Oudia Khatima, sous-directrice au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dresse un état des lieux sans concession : « Le défi majeur de la recherche scientifique reste le financement. » Malgré les efforts de l’État, elle estime que les ressources allouées demeurent insuffisantes.
Face à ce constat, le gouvernement a revu son engagement financier à la hausse. « L’État fournit l’effort de résoudre ce problème mais ça reste insuffisant », affirme Mme Khatima, soulignant une progression notable des crédits alloués à la recherche. « Le financement est passé de 8 à 18 milliards pour 2024-2025, soit une augmentation de 120% ».
Combler l’ensemble des besoins
Si cette évolution marque une avancée, elle ne suffit pas à combler l’ensemble des besoins du secteur. « Il faut savoir qu’il y a beaucoup de domaines d’activités qui sont vraiment des domaines de compétences », précise la responsable, plaidant pour une diversification des sources de financement.
Car au-delà de l’augmentation budgétaire, la recherche scientifique requiert une structuration plus fine et des mécanismes adaptés pour assurer un soutien pérenne aux laboratoires, chercheurs et projets innovants. « Le financement doit être diversifié », insiste Mme Khatima, soulignant l’importance d’une implication plus forte du secteur privé et des institutions internationales.
Domaines d’excellence en plein essor
Loin d’un tableau uniquement préoccupant, la sous-directrice met en avant des avancées significatives qui permettent à l’Algérie de se distinguer sur la scène scientifique. « L’Algérie est en train de se distinguer par rapport à certains domaines tels que l’agroalimentaire, l’engineering, l’informatique, l’hydraulique (dont la gestion de l’eau et le dessalement), les énergies renouvelables, les sciences des matériaux… etc ».
Pour soutenir ces progrès, le ministère a mis en place plusieurs stratégies visant à structurer la recherche et à maximiser son impact. « Ces mécanismes s’inscrivent en matière de recherche, en infrastructures scientifiques ou en matière d’innovation », explique-t-elle.
Dans cette optique, des programmes de recherche ciblés ont été définis, notamment autour de 3 priorités majeures : la sécurité sanitaire, la sécurité énergétique et la santé du citoyen. D’autres initiatives viennent compléter cet arsenal, comme les projets thématiques de recherche, les projets d’établissements, ou encore les réseaux thématiques de recherche.
Valorisation et transfert technologique
« Tout cet environnement est fait pour valoriser la recherche et répondre ainsi aux problèmes socio-économiques », rappelle Mme Khatima. Pourtant, force est de constater que les innovations algériennes peinent encore à trouver preneur.
« Le problème est que nous avons su nous valoriser pour nous vendre. C’est bien beau de faire des choses, mais il faut se tourner vers l’entrepreneuriat. Si nous ne savons pas valoriser notre travail, cela ne sert pas à grand-chose ».
Un constat sévère qui reflète un défi de taille, connecter les découvertes issues des laboratoires aux réalités du marché. La sous-directrice regrette ainsi un manque de visibilité des avancées scientifiques auprès des acteurs économiques. « La société n’est pas au courant de ce qui se fait à l’université », déplore-t-elle.
Pourtant, des avancées notables sont bel et bien là. « Beaucoup de choses se font, comme les logiciels, les puces électroniques, la voiture électrique », souligne-t-elle. Des prototypes prometteurs existent, mais ils restent dans l’ombre, faute d’une politique efficace de transfert technologique et d’un réseau de partenariats dynamiques avec le monde industriel.
Malgré ces difficultés, Mme Khatima observe une transformation progressive du monde universitaire algérien. « Longtemps réfractaire au changement, l’université a changé présentement de mentalité », reconnaît-elle. L’enjeu est désormais d’ancrer cette dynamique dans la durée et de l’aligner sur les standards internationaux.
« Maintenant qu’il y a l’esprit de l’entreprenariat, il faut passer à l’industrialisation et la commercialisation avec la coopération de plusieurs secteurs. » Un cap essentiel pour éviter que les innovations algériennes ne restent cantonnées aux laboratoires.
Vers une coopération accrue
Cette nécessaire ouverture vers le monde de l’entreprise commence à se matérialiser. Plusieurs accords ont été conclus entre les universités et des entreprises nationales, à l’image de Sonatrach, en quête de solutions innovantes. « Cette coopération est actée évidemment par des conventions contractées avec des entreprises nationales comme Sonatrach, qui cherchent des experts pointus dans leurs domaines pour élaborer des stratégies ».
Ce rapprochement entre le monde académique et le tissu économique pourrait offrir de nouvelles perspectives aux doctorants et jeunes chercheurs. « Dans cette optique, des doctorants sont suivis de près, à travers les universités nationales, pour aider leur placement selon leur compétence et les projets qu’ils portent. »
L’Algérie semble avoir amorcé un tournant décisif dans la structuration de sa recherche scientifique. Si les avancées sont notables, les défis restent nombreux : le financement, la valorisation, l’intégration dans le tissu économique, le rayonnement international.