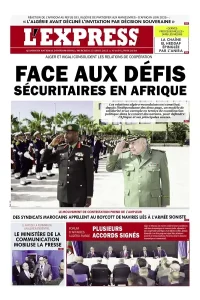Début 1957, la France est une puissance coloniale ; elle cherche à entrer dans le club fermé des « Puissances nucléaires ». Après l’essai Gerboise bleue, le 13 février 1960, la France devient la quatrième puissance nucléaire, après les États-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni.
Mais pourquoi le Sahara a-t-il été choisi ? La réalisation d’un site d’essais est tout d’abord envisagée sur plusieurs îles françaises d’Océanie. Cette solution est rapidement exclue pour des raisons de logistique. La Réunion, la Nouvelle-Calédonie et les îles Kerguelen sont elles aussi écartées. Le Sahara est rapidement choisi. Le site de Reggane, en Algérie, est arrêté le 23 juillet 1957. Les travaux y débutent le 1er octobre 1957. Ce centre d’essais était le CSEM (Centre saharien d’expérimentations militaires). Il deviendra le CEMO (Centre d’expérimentations militaires des oasis), plus tard à In Ecker.
Le premier essai nucléaire français, Gerboise bleue, est effectué le 13 février 1960 à 7 h 4 (heure de Paris), sous la présidence de Charles de Gaulle. Le développement de la bombe est poussé dès 1954 entre autres par Pierre Guillaumat et le ministre de la Défense nationale. Ces derniers convainquent le président du Conseil Pierre Mendès France d’autoriser la poursuite des recherches de l’industrie nucléaire, en indiquant que ces dernières seraient également positives pour le secteur civil de production d’électricité. C’est au début d’avril 1958 que Félix Gaillard, président du conseil sous la présidence de René Coty, décide que ce premier essai aura lieu au début de l’année 1960 et que le site de test sera localisé au Sahara.
Un champ de tir est créé à Reggane, au centre du Sahara algérien et à 600 kilomètres au sud de Bechar ; plus précisément à Hamoudia, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Reggane. Quatre tirs atmosphériques y seront effectués, trois depuis des tours et un au sol.
Le rapport annuel du CEA de 1960 montre l’existence d’une zone contaminée de 150 km de long environ. Mais en 2013, la carte classée « secret défense » des retombées réelles est divulguée montrant l’immensité des zones touchées, et ce jusqu’en zone subsaharienne. Des taux de radioactivité différents suivant le déplacement des particules de poussière contenant de l’iode 131, du césium 137 (note 002910 4 avril 2013).